LE MONDE EN 2017
Le grand retour des rapports de force
L’irruption de Donald Trump sur la scène mondiale est un facteur d’instabilité majeur. Mais les relations internationales n’ont pas attendu le nouveau président américain pour se redessiner radicalement à l’orée de 2017.D’aucuns disent déjà que c’est le 9 novembre 2016, dans les premières heures de la nuit, que “le XXIe siècle a débuté”. Avant même l’investiture de Donald Trump, le registre apocalyptique prédomine lorsqu’il s’agit d’imaginer le mandat de celui qu’on s’est résolu à appeler le 45e président américain. “Un monde s’effondre, tout est désormais possible”, tweetait l’ambassadeur français aux Etats-Unis Gérard Araud, prix de “vertige”, dans les minutes qui suivaient la victoire du milliardaire. “L’hiver est arrivé”, renchérissait le dissident russe Gary Kasparov. Deux mois plus tard, alors que le président-élu ne passe pas un matin sans demander des comptes à Pékin sur Twitter – sur le registre passif-agressif qu’on lui connaît – le pessimisme a à peine tiédi.Il est vrai que nous nous sommes tellement habitués à considérer la politique internationale à l’aune de l’identité du locataire de la Maison-Blanche qu’il semble certain que l’arrivée de Trump dans le jeu va coïncider avec une période de bouleversements – un sentiment renforcé par le baroud d’honneur diplomatique de John Kerry et Barack Obama, peut-être retombé sur son Nobel de la Paix en faisant ses cartons. Au vu des positions de son successeur, les fruits de la Conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien, le 15 janvier, seront peut-être caduques en 5 jours… La victoire de Trump alarmait en tant que symptôme : elle inquiète désormais en tant que fait. Là où Barack Obamatentait de forcer quelques verrous de l’histoire en nouant des accords avec ses ex-ennemis jurés – Iran, Cuba – Donald Trump s’entoure d’un état-major néoconservateur qui ne s’est jamais départi de sa théorie des “États-voyous”.
Avec Trump, “tout peut basculer” Surtout, encore choqués par la virulence de la campagne présidentielle, la plupart des observateurs se résignent à ce que l’échevelé businessman prenne sa place en 2017 dans le concert des Kim, Duterte, Erdogan, Poutine, Assad et consorts, consacrant le grand retour de la brutalité dans les discours géopolitiques. Un nouveau monde belliqueux et explosif où la démocratie à l’européenne, cet avatar si peu spectaculaire de la politique, serait condamnée à la solitude et à la figuration – à moins de couronner à son tour des radicaux forts en gueule. Haut du formulaireBas du formulaire
A quoi assistons-nous en réalité ? A rien d’autre qu’à l’émergence du puzzle multipolaire et complexe que la chute du Mur nous avait promis. Simplement, il ne ressemble pas du tout à celui que l’on s’était imaginé à l’époque. On ne s’attendait pas à ce que l’horizon national reste si indépassable. On ne s’attendait pas à ce que ce nouveau monde soit si conflictuel, si morcelé, si insensible aux idéaux des droits de l’homme ni si profondément traversé par la radicalité religieuse.
Dépeignant “un environnement international plein d’incertitudes, avec un climat de guerre froide” dans ses ultimes vœux aux Français le 31 décembre, un François Hollande de plus en plus crépusculaire ne dressait pas d’autre constat :
“Ce que nous croyions acquis parfois pour toujours – la démocratie, la liberté, les droits sociaux, l’Europe et même la paix – tout cela devient vulnérable, réversible. On l’a vu au Royaume-Uni avec le Brexit et aux Etats-Unis lors de l’élection du mois de novembre, on le voit sur notre continent à travers la montée des extrémismes. Il y a dans l’histoire des périodes où tout peut basculer. Nous en vivons une.”
Bigre, la guerre froide ! Les amateurs de contradiction ne manqueront pas d’arguer que Donald Trump apparaît déjà comme le président américain le plus russophile de tous les temps : il ne croit pas aux piratages russes, et considère à bien des égards Vladimir Poutine comme notre contemporain capital.
Donald Trump est-il davantage une menace pour les relations avec la Chine ? Son vrai-faux dérapage sur Taïwan, début décembre, a certes agacé Pékin ; mais le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a immédiatement réagi avec philosophie (“Je ne pense pas que cela changera la politique adoptée depuis des années par les Etats-Unis”), signe que la Chine a déjà opté pour un certain fatalisme face aux saillies trumpiennes.
L’économie américaine est aujourd’hui trop dépendante de la locomotive chinoise pour risquer un début de guerre commerciale. La volonté de Donald Trump de retirer les Etats-Unis du TPP (Traité transpacifique), un accord de libre échange spécifiquement conçu pour exclure la Chine, arrangerait même plutôt Pékin.
Une géopolitique d’homme à homme
Sa vision ultra-personnalisée des affaires mondiales est en tout cas à double tranchant.L’auteur de “The Art of the Deal” est un homme fermement animé par le fantasme qu’on peut régler n’importe quel problème en s’asseyant en tête-à-tête autour d’une table pendant une heure, et qui se sent personnellement capable de retourner n’importe quelle situation en sa faveur à coups d’esbroufe, de cajoleries et de fausses confidences. Cette confiance en lui, cette conception “d’homme à homme” de la politique, a été sa plus grande force et sera sa plus grande fragilité. Son admiration envers Vladimir Poutine n’est si forte que parce qu’il s’attend à ce que ce dernier la lui rende ; il ne pourra pourtant jamais parler sur un pied d’égalité avec lui, ne serait-ce parce qu’au contraire de Poutine, un président américain a mille rouages institutionnels et médiatiques à qui rendre compte, comme le note cette semaine Garry Kasparov.
Et là où l’administration Obama s’en prend classiquement à l’économie russe plutôt qu’aux réseaux Poutine, ce dernier n’hésite pas à frapper personnellement – dix ans plus tard, Nicolas Sarkozy s’en souvient encore.
Donald Trump peut-il supporter le même genre d’intimidation ? Il offre en tout cas de nombreux points vulnérables, à commencer par la présence massive des membres de sa famille dans les lieux de pouvoir. Au moins deux de ses nouveaux lieutenants ont des intérêts personnels sur le sol russe : son futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson, PDG de la major pétrolière ExxonMobil, et son futur secrétaire au Commerce, le milliardaire Wilbur Ross. Enfin, la minceur de ses convictions factuelles et idéologiques le rend éminemment réceptif aux discours de charme.
Cette prime donnée à la personnalisation du pouvoir sur la logique de représentation propre à l’Occident déforme les perceptions. Elle donne aujourd’hui le sentiment paradoxal, et pourtant largement partagé, que les cartes sont désormais entre les mains d’une demi-douzaine de puissances moyennes, dotées d’une capacité de nuisance – Russie, Turquie, Israël, Iran, Arabie saoudite pour ne citer qu’elles. Autant de poids lourds régionaux qui ont pour point commun de savoir se rendre incontournables et de jouer admirablement entre deux eaux.
Irak-Syrie
Le redécoupage qui vient
La meilleure preuve de cette recomposition ? La capacité d’Erdogan à faire chanter l’Europe sur les 3 millions de réfugiés syriens coincés sur son sol tout en continuant de brandir les négociations d’adhésion à l’UE ; à organiser une purge massive de tous les contre-pouvoirs en Turquie sur le prétexte d’un putsch d’amateurs ; à nouer unconcordat militaire avec Moscou tout en demeurant sous le giron de l’Otan ; et à se permettre de bombarder en même temps les deux belligérants du nord de la Syrie – Daech, dont il a aidé le développement quand les djihadistes l’arrangeaient, et les milices kurdes, soutenues par l’Occident. Le tout avec une popularité inentamée, largement bâtie sur lesdivisions ethniques et religieuses du pays, qui lui permet d’envisager de rester aux commandes jusqu’à 2024. Un nouveau référendum constitutionnel, en avril, devrait encore étendre l’étendue de ses pouvoirs personnels.
Un autre homme est dans l’œil du cyclone, et tout surpris de s’y trouver sain et sauf : Bachar el-Assad. Il était le dernier domino des printemps arabes, et il n’est pas tombé. La reprise d’Alep, qu’on disait impossible, a été achevée en trois mois, par un écrasement aérien continu associé à un intense travail d’infiltration au sol ; sa première grande victoire en presque 6 ans de guerre. Privés de tout espoir de victoire, les derniers milliers de rebelles, patchwork indéchiffrable de groupuscules armés par l’Occident et les pays sunnites, attendent d’être neutralisés dans la région d’Idlib. La trêve laisse les mains libres au régime pour reprendre Palmyre à Daech. De l’autre côté de la frontière, en Irak, Mossoul est sur le point de tomber. Au profit de qui ? Laguerre aborde une nouvelle phase mais est loin de s’achever.
Dans ce Vietnam moderne – un bourbier géostratégique où les grandes puissances font s’affronter leurs intérêts via des factions-écrans – la débâcle annoncée des djihadistes risque d’amorcer une périlleuse tentative de redécoupage des frontières. Les Kurdes ne font pas mystère de leurs intentions de conserver les territoires dont ils se sont emparés à la faveur des combats : après Kirkouk en Irak, ils se verraient bien en Syrie reprendre Raqqa, capitale de l’Etat-fantoche de Daech, avec la bénédiction de l’Occident. Contrainte d’accélérer, la Turquie d’Erdogan, elle, considère les ambitions de son éternel “ennemi de l’intérieur” avec effroi – et considère disposer d’un droit historique sur le nord de l’Irak, cédé dans les années 1920 sous pression de l’Empire britannique. Les chiites, dont les milices sont armées et encadrées par l’Iran, profitent également de leurs victoires sur le terrain pour regagner leur influence perdue à Bagdad.
Cet échec de l’endiguement de l’influence de Téhéran dans la région a pour effet de susciter la panique des pays du Golfe, l’Arabie saoudite (3e budget militaire mondial) en tête, qui considère les efforts de son protecteur américain pour ramener l’Iran dans le concert des nations comme une trahison. C’est cette panique des Saoud, subitement devenus interventionnistes, qui est à l’origine du martyre du Yémen. L’Iran y arme une autre mouvance chiite, les Houthis (dont le slogan est “Dieu est le plus grand, mort à l’Amérique, mort à Israël”), qui a bien failli renverser le gouvernement dans la foulée des printemps arabes, et dont l’écrasement par la coalition arabe provoque une crise humanitaire d’ampleur : la faim frappe 2 millions de personnes, et une partie sont déjà sur les routes.
Migrants
L’UE n’a rien résolu
C’est le genre de situations qui, outre le drame humain, fait les cauchemars de Bruxelles. En matière d’immigration comme dans tant d’autres domaines, l’Europe s’est habituée à parler de “crise”. Depuis un an, le rythme des arrivées par la Grèce, verrouillées avec l’aide turque (moyennant un accord à 6 milliards d’euros), a certes été divisé par 10. Via l’Afrique et l’Italie en revanche, le nombre d’arrivées – et de morts – a augmenté. Et les solutions, elles, n’ont pas progressé : sur les 172.000 migrants arrivés sur les côtes grecques en 2016, seuls 633 avaient été reconduits en Turquie au 7 octobre dernier, et 2.217 Syriens (sur 80.000) avaient été réinstallés dans l’Union.
L’UE, qui a mis l’essentiel des moyens sur la surveillance en mer et la lutte contre les passeurs, continue à l’arrière de composer avec le refus de plusieurs pays de participer au plan de relocalisation des réfugiés. Outre les chantages émotionnels et l’angoisse démographique, les gouvernements doivent désormais composer avec une menace terroriste fantôme, intimement liée dans les opinions à ces vrais-faux réfugiés aux identités multiples de Saint-Denis ou Berlin.
En acceptant tacitement le concept hardi de “solidarité flexible”, défendu en septembre par les pays d’Europe centrale, le Conseil européen a capitulé en rase campagne. En alliant le pire du fédéralisme au pire de l’égoïsme national, l’UE n’a décidément jamais autant ressemblé à une ONU en plus petit que ces deux dernières années. Mésententes en cascade des renseignements face à la menace de Daech, psychodrame du Brexit, élections à hauts risques (Italie, Pays-Bas, France, Allemagne) et pulsions séparatistes à l’horizon (référendum catalan à l’automne, Ecosse) : le projet européen vacille.
Gendarme contraint en Afrique de l’ouest, la France déploie ses forces dans une dizaine de pays, notamment via les ruineuses opérations Barkhane (500 millions d’euros par an) et Sangaris, dans la hantise de voir s’entendre les métastases du djihadisme (Mali, Djibouti) et de la violence ethnique (Centrafrique, et ailleurs Burundi, Sud-Soudan). La France, pas l’Europe, qui paie pourtant dans son ensemble les dérèglements du continent ; la doctrine, François Hollande l’a encore rappelée le 31 décembre:
“La France se bat pour le développement de l’Afrique et la réduction des inégalités car elle sait que là se situe le règlement des migrations.”
Il ne s’agit plus seulement de bonnes relations post-coloniales : le Quai d’Orsay se tourne désormais vers plusieurs nations anglophones et a notamment signé au printemps 2016 un accord de coopération sécuritaire avec le Nigeria.
Le Nigeria ? Qui sait que le Nigeria a été en 2016 le premier pays d’origine des migrants en Europe (36.000), après la Syrie (79.000) et l’Afghanistan (42.000) ? La première économie d’Afrique est aussi une poudrière démographique. En le regardant sur une carte du monde, difficile de concevoir que ce pays grand comme deux fois la France, miné par la corruption et la barbarie de Boko Haram au nord, pourrait frôler le milliard d’habitants au début du siècle prochain, selon la projection médiane de l’ONU. Il est pourtant entré en récession cet été, dans un contexte de bas prix du pétrole, un secteur qui représente 70% des recettes publiques du pays.
Lagos, qui a vu sa population décupler en 40 ans, est la première ville d’Afrique depuis 2012
Le pétrole joue son rôle de révélateur
Comme souvent ces dernières décennies, les caprices du baril (sous les 50$ pendant 18 longs mois) font office d’accélérateur de l’histoire. Le Venezuela, vitrine de la gauche sud-américaine triomphante pendant la décennie 2000, vit une descente aux enfers depuis la mort de Hugo Chávez en 2013 : pénurie, hyperinflation (475% en 2016) et incertitude politique ont suivi immédiatement l’effondrement des cours de l’or noir. Celui-ci a précipité la chute de la compagnie nationale brésilienne Petrobras, révélant l’ampleur colossale de sa dette (100 milliards de dollars) et embourbant dans une vaste affaire de corruption le si populaire tandem Rousseff-Lula : processus de destitution pour la première, péripéties judiciaires sans fin pour les deux.
Naguère en relative bonne santé économique, d’autres pays doivent serrer les dents. C’est le cas de l’Arabie saoudite, de l’Algérie, de l’Angola, de la Russie, tous hautement hydrocarbures-dépendants. Chacun réagit différemment : certains par le repli, d’autres en entretenant une apparence de puissance sur la scène internationale. L’administration Poutine a opté pour cette seconde solution, renforçant les moyens militaires et nucléaires, finançant à coups de millions des antennes médiatiques de plus en plus influentes en Occident, enchaînant les coups de force – Crimée, Syrie, incursions dans l’espace maritime et aérien français, “ingérence” dans la politique intérieure américaine sans réelle rétorsion, blocage systématique du processus onusien. Autant de manœuvres qui participent à camoufler aux Russes eux-mêmes l’économie fragile, le délabrement des infrastructures et l’inertie démographique du pays. Deux Russes sur trois estiment vivre dans une “grande puissance”, selon un sondage Levada au printemps dernier.
Cette stratégie agressive impressionne tout aussi bien l’Occident : ce n’est pas pour rien que le magazine “Forbes” a désigné Vladimir Poutine “homme le plus puissant du monde” pour la quatrième année consécutive. Mais il faudrait se garder de tresser trop complaisamment des louanges à ses dons de stratège.
La Chine s’impatiente
Dans les tactiques de Vladimir Poutine, tout concourt depuis dix ans à rééquilibrer l’équilibre mondial au détriment de l’hégémonie américaine ; pour ce faire, il a notamment tenté de recréer le “glacis” d’Etats-satellites et le réseau d’alliances qui étaient ceux de l’URSS à l’heure de la Guerre froide. Force est de constater l’échec de cette dernière stratégie : la prédation de la Crimée aurait plutôt eu tendance à activer un réflexe de recul des Etats baltes ; l’assistance jusqu’au-boutiste au régime Assad lui a valu des accusations de “crimes de guerre” ; les alliances avec la Turquie et l’Iran sont largement circonstancielles, et reposent sur un engrenage d’intérêts économiques communs et une logique “anti-Occident” attrape-tout.
Si la Russie veut incarner un vrai modèle d’opposition à la “Pax americana”, elle sait qu’elle doit se tourner tôt ou tard vers la Chine. Jusqu’à un passé récent, les deux puissances s’observaient en silence, voire avec une certaine indifférence. Mais un signe de rapprochement ne trompe pas : alors que la Chine avait pour tradition de s’abstenir plutôt que de s’opposer aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, Pékin et Moscou ont mis un veto commun à sept reprises depuis 2007, dont cinq fois sur le conflit syrien.
Le dernier veto commun, le 5 décembre, a empêché l’entrée en vigueur d’une trêve à Alep, lors de l’écrasement final de la zone rebelle. Un soutien explicite, alors que la Chine s’en était toujours officiellement tenue à une neutralité de principe sur le conflit syrien. Quelques mois plus tôt, le président chinois Xi Jinping et Poutine avaient affiché, lors d’une rencontre à Pékin, une condamnation commune de la course aux armements et de l’expansionnisme occidentaux. Étaient visés, sans les nommer, les Etats-Unis : à la fois pour l’installation de systèmes antimissiles en Europe et en Asie, les mouvements de navires en mer de Chine et le renforcement des liens diplomatiques avec plusieurs pays d’Asie du Sud-Est (notamment le Vietnam).
Jusqu’ici si prudente, la Chine, qui commence à observer un ralentissement économique et une surpollution aux conséquences imprévisibles, s’impatiente de récolter les fruits géopolitiques de son long et studieux travail de thésaurisation et de conquête de marchés. La mer de Chine méridionale, que lorgnent dix Etats, se barde d’îlots poldérisés sous étendard chinois, qui poussent comme des champignons. Des hangars pour avions sont mêmeapparus en 2016 dans les îles Spratleys. Autre offensive moins médiatisée, le “Collier de perles” de ports d’escale commerciale financés par Pékin, véritable réseau de comptoirs déguisés, qui orne depuis peu toutes les côtes de l’océan Indien : une base navale doit ouvrir cette année à Djibouti. Le dernier maillon d’un encerclement total du grand rival indien, première population mondiale en 2020, lui aussi tenté par l’affirmation nationaliste et dont la croissance s’accélère.
Forcément anecdotique mais tout aussi révélateur : Xi Jinping, fan frustré de ballon rond, a donné son feu vert pour que les clubs chinois arrosent d’argent les meilleurs joueurs du Vieux continent et déplacent le centre de gravité du football mondial. La star portugaise Cristiano Ronaldo aurait refusé fin 2016 un salaire de 100 millions d’euros par an… pour évoluer dans un championnat encore largement anonyme. Pour combien de temps
Avec Timothée Vilars



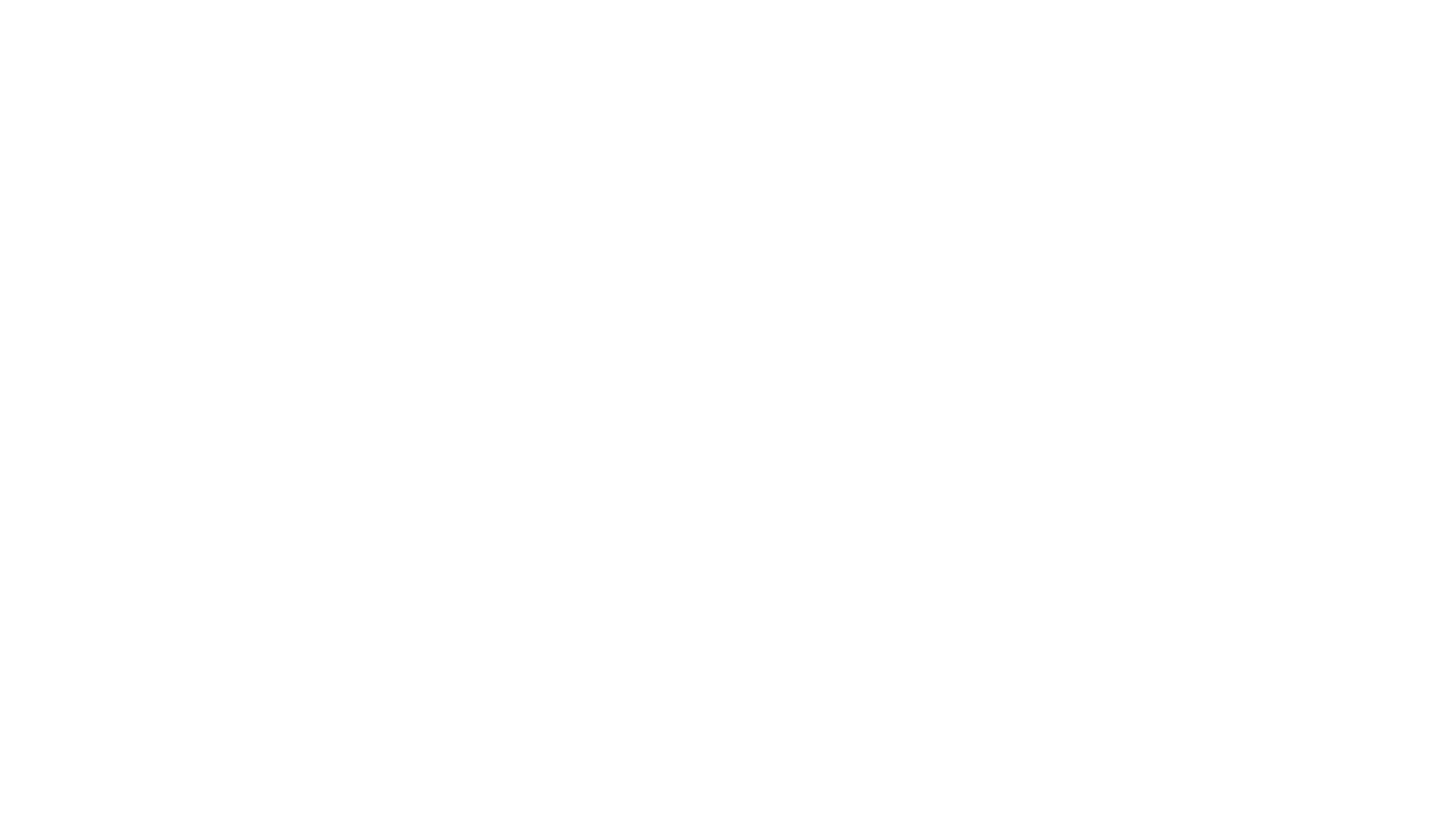
Average Rating