LE TRAVAIL FORCÉ AU SENEGAL
Mythes et réalités
En 2016, à la faveur du déménagement des Archives nationales du Sénégal (ANS), la lumière commence à se faire sur le travail forcé par delà l’abolition de 1946
Le professeur Romain Tiquet, docteur de la Humboldt Universität (Berlin) en histoire de l’Afrique, après avoir mené des recherches sur l’histoire de la police et du maintien de l’ordre colonial au Burkina Faso, s’est penché sur la question du travail forcé au Sénégal au XXe siècle.
Le travail forcé en Afrique coloniale française est officiellement aboli par la loi Houphouët-Boigny en 1946 ; qu’en est-il réellement sur le terrain ?
Cette loi marque une rupture à la fois fondamentale et paradoxale dans la politique coloniale car elle abolit des pratiques qui ne sont plus censées exister depuis la ratification par la France en 1937 de la Convention du Bureau International du Travail (BIT) sur le travail forcé de 1930.
De plus, bien que concise et directe, cette loi ne propose ni définition claire de ce qui est considéré comme travail forcé, ni sanction en cas de non respect de la loi. Ces carences laissent alors le champ libre aux autorités coloniales pour continuer à utiliser la contrainte dans le recrutement des travailleurs.
L’un des exemples les plus symptomatique est la deuxième portion du contingent. Dans chaque colonie, le recrutement militaire annuel distingue la première portion de militaire d’une seconde portion du contingent, recrutée pour travailler sur les chantiers de travaux publics de l’AOF. Cette seconde portion jouit d’un statut à la fois militaire et civil qui créé un certain flou juridique. Cette ambiguité statutaire a été habilement utilisée par le régime colonial pour contourner la loi de 1946 et recruter jusqu’au début des années 1950, principalement au Sénégal, des milliers de travailleurs forcés pour la construction de l’aéroport et du port de Dakar.
D’autre part, les débats sur le Code du travail d’Outre mer qui se tiennent entre 1946 et 1952 révèlent l’obsession de certains coloniaux qui persistent à penser que seule la contrainte dans le recrutement de la main-d’œuvre peut garantir le bon fonctionnement politique et économique des colonies. On assiste par exemple à l’introduction de certains amendements – rejetés par la suite – de députés proposant de réintroduire des formes de travail forcé telles que la réquisition pour les entreprises privés ou la main-d’oeuvre pénale. Ils justifient ces propositions pour lutter contre la pénurie ou la mauvaise volonté des populations, considérées, encore à cette époque, comme « indolentes ». Ces stéréotypes racistes, base de légitimation du travail forcé au début de la conquête coloniale, ont la peau dure et les mentalités de certains ne sont pas encore prêtes à être réformées.
Après l’indépendance du Sénégal, comment le régime de Senghor envisage-t-il cet héritage ?
A première vue, le régime de Senghor, inspiré par la voie socialiste et l’animation rurale, met en place une planification du développement, impulsant de nouvelles relations entre l’État et les populations dans un esprit de rupture nette avec la période coloniale. Cependant à y regarder de plus près, on peut souligner une certaine continuité avec la période coloniale dans les répertoires discursifs et les pratiques utilisées par les élites sénégalaises dans les politiques de mobilisation de la main-d’oeuvre.
Dans la rhétorique de l’époque, les élites postcoloniales sénégalaises appellent à la mise au travail des forces vives de la nation et stigmatisent dans le même temps l’inactivité et l’oisiveté, considérées comme frein à la construction nationale. Pour les pouvoirs publics, la survie sans travail est suspecte. Les années 1960 au Sénégal sont marquées par la répression de ce que le régime qualifie de « fléaux sociaux », catégorie déjà utilisée par l’administration coloniale pour décrire toutes les populations suspectes aux yeux du pouvoir (vagabonds, jeunes inactifs, fous, prostituées, lépreux, etc.).
Le discours des autorités sénégalaises produit un effet d’inclusion/exclusion en érigeant le travail comme valeur morale mais aussi comme « baromètre » où se mesure le degré de participation à la construction nationale et l’adhésion au projet politique. Ce discours inclut toutes les personnes prêtes à s’investir pour la construction nationale mais exclut dans le même temps, en mettant « hors la loi » ou en dehors de la norme « travail », toutes les populations jugées inactives ou marginales.
Les officiels coloniaux parlaient de « mission civilisatrice » pour justifier la conquête. On peut très bien dire qu’avec ce discours productiviste et la stigmatisation de certaines catégories de la population, la jeune république sénégalaise se veut, elle aussi, en quelque sorte « civilisatrice ».
Quelles formes de mobilisation de la main-d’oeuvre retrouvent-on après les indépendances ?
Dans la plupart des états d’Afrique francophone, une large place est faite aux « investissements humains ». Ce concept, apparu à la fin des années 1950, mise sur l’apport volontaire et bénévole de main-d’œuvre pour la réalisation de projets d’infrastructures. Pour un pays confronté au sous-emploi et qui souhaite réaliser les travaux économiques indispensables pour son développement, cette solution est idéale. Cependant, on peut noter de nombreux abus dans son application, en particulier dans les conditions de recrutement. En m’intéressant à certains projets au Sénégal, j’ai pu déceler des formes de ce que je qualifie de « bénévolat obligatoire » : des centaines d’individus sont recrutés de manière forcée par les chefs de village pour rénover une route, construire une école etc. Sur le papier les populations sont bénévoles, dans les faits elle sont contraintes à travailler sous peine de sanctions.
Par ailleurs, dans un contexte de lutte contre le chômage et de déruralisation de la jeunesse, plusieurs formules de service civique sont introduits dans les jeunes Etats afin de mobiliser la jeunesse pour le développement du pays et leur fournir une formation professionnelle et civique. Sous couvert d’intégrer socialement les jeunes, ces services civiques, encadrés militairement pour la plupart, ont souvent été détournés pour fournir un réservoir de main-d’oeuvre pour les chantiers publics du territoire.
Ironie de l’histoire, les services civiques font l’objet d’une attention toute particulière du BIT au milieu des années 1960. Le BIT considère en effet que l’enrôlement militaire de la jeunesse à des fins de participation en travail à la

construction nationale est une forme de travail forcé. Plusieurs pays africains francophones, en particulier le Mali, furent mis en cause et réagirent avec virulence. Ils sont attaqués d’un crime « colonial » alors même que tout leur appareil discursif et les politiques menées se veulent être en rupture avec les pratiques coloniales passée
Avec Africa4



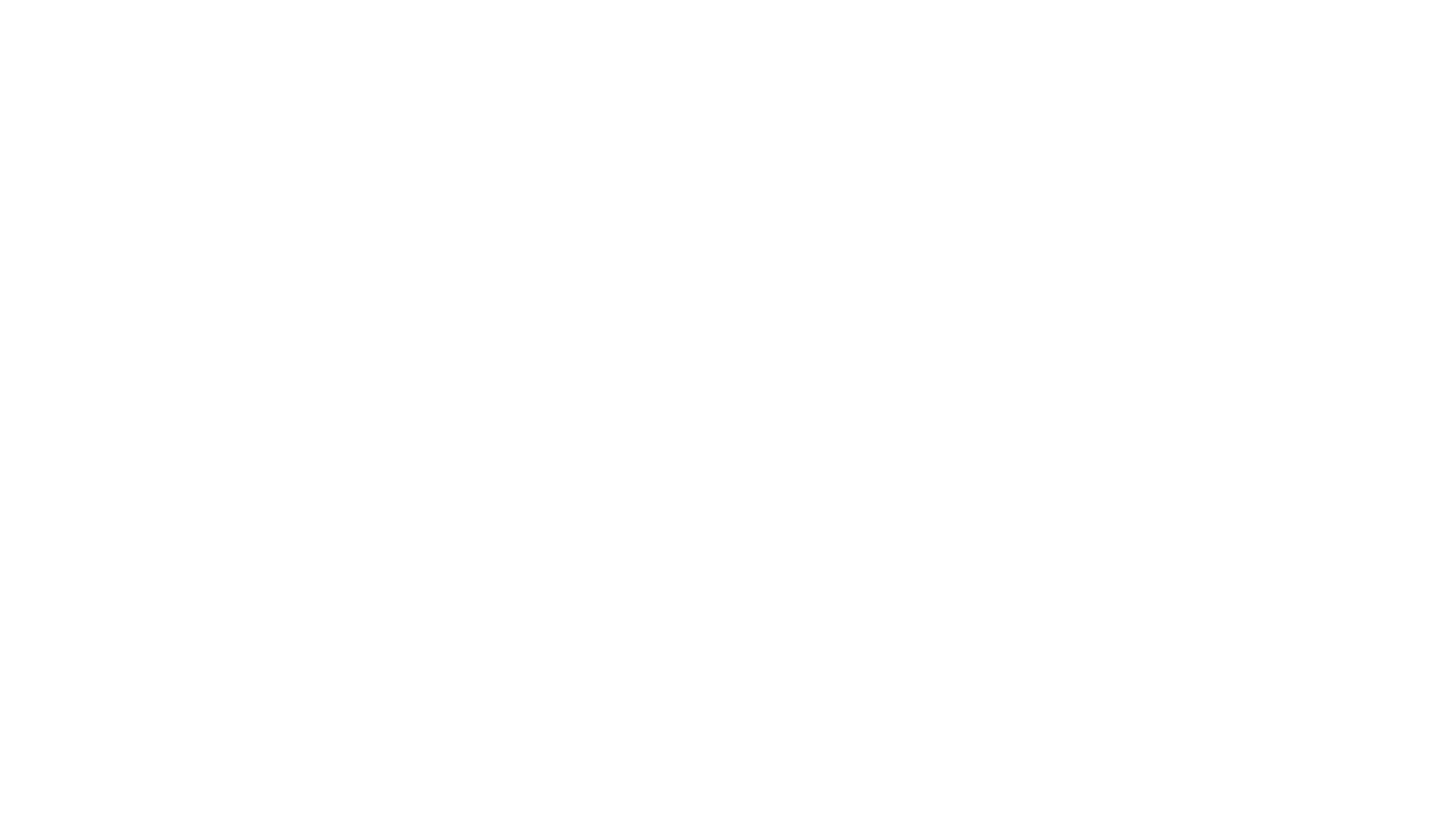
Average Rating